|
Nous avons vu comment, en Italie, deux grands saints: Filippo
Neri et Charles
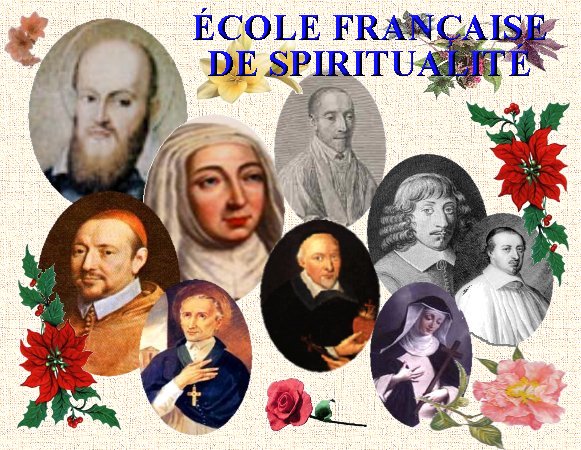 Borromée,
avaient vigoureusement travaillé à une nouvelle œuvre d’évangélisation. Grâce à
eux, à leur exemple et au courage de leurs condisciples, le clergé et le peuple
se convertissaient. Et quand cela était nécessaire, les évêques eux-mêmes
payaient de leur personne pour soigner les malades ou venir en aide aux pauvres. Borromée,
avaient vigoureusement travaillé à une nouvelle œuvre d’évangélisation. Grâce à
eux, à leur exemple et au courage de leurs condisciples, le clergé et le peuple
se convertissaient. Et quand cela était nécessaire, les évêques eux-mêmes
payaient de leur personne pour soigner les malades ou venir en aide aux pauvres.
Nous le savons, la sainteté est contagieuse. Elle sait aussi
traverser les frontières. Ce qui se passait à Milan ou à Rome fut rapidement
connu, et des hommes de prière et d’action entreprirent, dans plusieurs pays
européens, de suivre la voie qui leur était montrée afin de mieux travailler au
salut de leurs peuples.
De la France, spirituellement blessée par la Renaissance et
menacée par l’avancée de la Réforme protestante, jaillirent des hommes d’une
très grande valeur humaine, pleins d’une foi profonde et d’un zèle communicatif.
Ces hommes donnèrent naissance à une spiritualité qui mettait en évidence
quelques facettes oubliées de l’enseignement du Christ. La profonde prière de
ces hommes se concrétisait par des œuvres multiples qui n’avaient qu’un but:
réformer l’Église de France et sauver le peuple meurtri par les guerres civiles
ou étrangères.
C’est la spiritualité de cette époque, qui recouvre à peu
près les règnes de Henri IV et de Louis XIV, que l’on qualifia plus tard d’École
Française. Des études approfondies sur la spiritualité de l’École
Française ont déjà été réalisées par d’éminents théologiens. Nous n’y
reviendrons pas. Notre propos n’a pour seul but que la contemplation de ceux
qui, ayant su vivre cette spiritualité avec beaucoup de foi et d’amour, sont
devenus les grands saints dont nous admirons encore la plupart des œuvres.
Nous passerons donc en revue quelques-uns des grands hommes
(et femmes) connus ou moins connus, à qui, trop souvent sans le savoir ou sans
s’en souvenir, l’Église et le peuple de France doivent tant. Nous commencerons
par Madame Acarie, cousine de Bérulle, qui fut, avec ce dernier, à l’origine de
l’introduction du Carmel réformé en France. Puis nous cheminerons avec saint
François de Sales qui est né seulement deux ans après la fin du Concile de
Trente, et qui, ayant connu Philippe Néri, fit, à Thonon, en Savoie, et avant
Bérulle, un essai de fondation d’un Oratoire en France.
Et nous continuerons notre chemin avec Bérulle, le Père de
Condren et Marie des Vallées, la grande mystique normande qui fut si contestée.
Nous découvrirons aussi Alain de Solminihiac, le saint Évêque de Cahors, saint
Jean Eudes, Agnès de Langeac et Jean-Jacques Olier. Nous marcherons ensuite avec
Gaston de Renty et Catherine de Bar. Enfin notre route nous conduira jusqu’au
Père La Colombière, à Marguerite-Marie, la messagère du Sacré-Cœur, et à
Louis-Marie Grignion de Montfort.
Nous étant attardés sur les principaux acteurs de l’École
Française, nous essaierons de comprendre, et, peut-être, de mettre en œuvre
leurs conseils. Nous verrons combien ces conseils sont toujours actuels, même si
l’on doit, de temps en temps, modifier ou préciser leur vocabulaire devenu
parfois désuet.
Pour faciliter notre lecture, nous présentons d’abord
ci-dessous et très rapidement, ceux qui, de près ou de loin, ont “fait”
l’École Française. Il sera temps, ensuite, d’approfondir la vie de ces
personnes, de découvrir les richesses de leur spiritualité, et surtout de leur
amour pour le Seigneur, ce Quelqu’un, à qui ils avaient donné leur vie.
|
